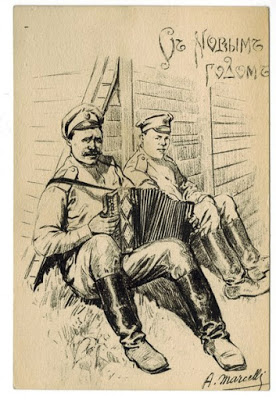Nous publions ci-dessous un témoignage paru dans « La Revue de Paris » en 1920. L’auteur, André Obey, y raconte l’été 1917 sur le plateau de Millevaches en Creuse, où le régiment d’infanterie du narrateur fut missionné non loin de La Courtine pour participer à la répression de la mutinerie des soldats russes, retranchés dans le camp militaire. Le texte a été déposé le premier décembre 1920 à la Revue et a été publié dans son sixième tome de novembre- décembre 1920.

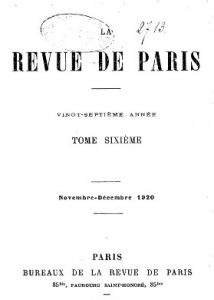
André Obey Revue de Paris Nov-Dec 1920
CAMARADES ROUSKI
(AOÛT -SEPTEMBRE 1917)
À madame Edmond Blanguernon.
Fécondante discipline, que l’on te
doit de chants de liberté
CH. BAUDELAIRE
I
Le 3 août 1917 il faisait un temps affreux dans le Limousin. En qualité d’infirmier, je marchais derrière une compagnie de jeunes soldats. À ma droite, les têtes sonnaillantes des mules de la voiture médicale. À ma gauche, mon brave camarade le caporal-mitrailleur Gental. Nous suivions la route qui va d’Eymoutiers, dans la Haute-Vienne, à Gentioux, dans la Creuse. Nous longions sans entrain de sombres lignes d’arbres qui bruissaient sous l’averse. Au loin une frise de collines bleues se dessinait sous le ciel jaune. -Autour de nous un paysage plat, sans perspective aérienne, une grisaille qui semblait, à travers les raies obliques de la pluie, une mauvaise esquisse sabrée à coups de crayon.
– Eh bien, Gental !
– Eh ben, vieux zig. Ça flotte.
– Où va-t-on ?
– Quéque ça peut f…? dit Gental avec une admirable indifférence qu’il n’eût pas montrée s’il n’avait respiré, parmi les relents moisis des capotes mouillées, l’odeur impérieuse de la discipline.
Les jeunes soldats de la classe 18 s’obstinaient à considérer l’expédition comme une partie de plaisir. Ils portaient allègrement sur l’épaule un fusil Lebel, et des balles D dans leurs cartouchières ; ils croisaient aux carrefours des batteries de 75 dont les lourds caissons cahotaient aux ornières. Une expérience, même brève, de la guerre les aurait avertis qu’il ne faut jamais plaisanter avec les armes à feu. Mais ils riaient, chantaient, hurlaient comme… juste comme nous – les vieux – qui, trois ans auparavant, jour pour jour le 4 août 1911 – descendions les rues de Lille avec fusils, cartouches et canons, la même joie que les jeunes soldats, le goût des aventures et la certitude de vaincre.
Devant nous, sur cinq cents mètres de route, les casques bleus de pluie dansaient comme mille petites vagues rondes. L’aigre odeur des capotes trempées flottait dans le vent chaud.
– N’iront pas longtemps de ce train-là, – me dit Gental.
Ils allaient, pourtant, depuis plus de quinze kilomètres. et quand on s’arrêta pour la grand’halte, ma voiture était vide.
– Bon Dieu ! – dit Gental aux bleus qui regardaient goguenards mon brassard à-croix rouge en enfournant d’énormes bouchées de singe, – bon Dieu ! les gosses, faudra voir à ne pas vous faire porter malades pour des bobos. Quand qu’on abat abat quinze kilomètres sans accroc, y a pas d’place à l’infirmerie.
On repartit, et les bleus, dont beaucoup avaient dormi dans l’herbe mouillée, montrèrent des faces blêmes et traînèrent la jambe. Il y eut des à-coups dans la marche. Les sections s’entrechoquèrent comme les wagons d’un train qui manœuvre. Les bleus ne chantaient plus. Des jurons jaillirent le long de la colonne. C’est curieux comme la fatigue suit de près la grand’halte. On croirait que c’est quelqu’un qui vous attend, assis sur une borne (celle qui marque le vingtième kilomètre), se lève à votre approche et vous touche tous au passage. D’un bloc, le silence tombe. Chacun se retire en soi-même, se tâte avec soin, de la tête aux pieds, comme un chien qui cherche ses puces. Délicatement, muscle à muscle, on note avec inquiétude les modifications – les moindres – dont la fatigue altère l’organisme. C’est le moment désagréable où les pierres se placent d’elles-mêmes sous les pieds pour les tordre, où le filet d’eau qui se déroule au long de votre échine use du froid, du chaud, du chatouillement, avec des nuances exquises.
Comme j’observais que mes jambes se déplaçaient tout d’une pièce sans que l’articulation du genou ni celle du pied consentissent à jouer, j’éclatai brusquement :
– Bon sang d’sort, où va-t-on, mais où va-t-on ? Ça commence à être la barbe
Gental coula vers moi un regard ironique, à ras de son casque cliquetant de pluie :
– Quéque ça f… de l’savoir, pisqu’on doit y aller ?
Près de nous, un officier chevauchait, énigmatique et renfrogné, serré dans son caoutchouc dont les pans ruisselaient sur la croupe lustrée de sa bête. Il entendit la réplique de Gental et le regarda fixement au passage.
– C’est l’capitaine Dubois, souffla Gental, un copain à moi.
– Eh bien! – dis-je, – demande-lui où on va.
La route serpentait entre des bois épais, toujours fermée d’un rideau d’arbres. Un à un les casques s’accrochèrent aux musettes. Des coups d’épaule redressèrent des sacs. D’un bout à l’autre de la colonne un carillon de chaînettes et de gamelles tinta. Et enfin retentit un bruit de pas spécial, un lourd traitement de pieds qui n’appartient qu’aux soldats fatigués, ceux qui vont droit devant eux, qui s’en voudraient de faire un détour d’un demi-mètre et qui, pour rien au monde, n’éviteraient les obstacles.
Pour ma part, j’écoutais avec hébétude le chuic… chuic… spongieux de mes pieds dans mes brodequins pleins d’eau.
– Vise ce petit-là, – me dit Gental, – va caler !
Hagard et soufflant, le petit n’avançait plus qu’avec le déhanchement laborieux, le roulis d’épaules d’un ascensionniste sur une côte raide. Sa figure écarlate, luisante de pluie et de sueur offrait l’effrayante grimace d’un homme à qui l’on vient d’apprendre un grand malheur. À chaque pas, son cou s’allongeait, se décharnait, et sa tête, dont le crâne rond et ras fumait, pointait devant lui en secousses brusques comme celles d’une poule qui picore. Il buta contre une pierre et s’étala. Je le relevai et le hissai en voiture. Mais le petit bleu, en reprenant haleine sur une cantine médicale; avisa Gental qui souriait derrière la fumée de sa pipe, et, furieux :
– C’est malin de rire, vous, caporal, vous n’avez pas le sac.
– Bah – dit Gental, indulgent, – tu as fait vingt-cinq kilomètres avec le barda complet. C’est pas si mal…
Nous traversâmes au crépuscule un triste village de la Creuse. Aux vitres sales des chaumières parurent des têtes soupçonneuses de vieilles femmes dont les bouches édentées mâchaient ou marmottaient des choses. Sur le ciel où couraient des nuées d’orage, la tour ventrue d’une antique église penchait à tomber. Nous emplîmes de tumulte la rue fangeuse, les vieilles disparurent et le village nous sembla charmant d’accueil et de confort quand nous sûmes que nous n’y resterions pas.
« Quand Madelon vient nous servir à boire… », la chanson de route, lancée par un gradé, retomba sans écho. La voix du commandant cria :
– Encore un kilomètre ! … Allons ! du cran ! Ça se tire !…
Gental me donna un coup de coude :
– Je l’attendais, celle-là, – dit-il.
Et, de voir les têtes des bleus se redresser et leur pas se relever, il éclata d’un large rire :
– Ça prend, tu vois, ça prend toujours ! … On nous l’a fait aussi. Rappelle-toi, vieux, les étapes de Belgique. Hein ? Encore un kilomètre ! … Combien Qu’on’nous l’a dit de fois !… On arrivait toujours et on n’arrivait jamais! Bon Dieu! Quand je repense à ce temps-là, je me demande si de Charleroi à Épernay y a plus d’un kilomètre. Il pouvait être dix heures du soir quand nous arrivâmes au cantonnement. Déjà je me glissais dans ma paille sans vouloir autre chose que dormir, dormir et dormir. Mes yeux clignotants, regardaient vaguement la silhouette noire de Gental debout dans le cadre de la porte. Par instants, la lueur de sa pipe rougissait sa figure éveillée. Il voulait savoir quelque chose.
Longtemps après, j’entendis la paille bruire à mes côtés, puis la voix de Gental me souffla à l’oreille :
– J’ai vu l’adjudant, dis donc. C’est contre les Russes qu’on marche. Paraît qu’y chambardent le camp de la Courtine.
– Ah bah! les Russes, murmurai-je; mais j’avais trop sommeil.
Gental s’étira, bâilla, frictionna ses membres las. Et, comme je lui tournais le dos avec humeur :
– Vieux, – dit-il, d’une voix inspirée, – comme c’est facile de faire marcher des hommes. On leur dit rien. Ou, si qu’on leur parle, on leur donne des faux tuyaux.
– Et quand les hommes s’en aperçoivent ? – dis-je.
– Oh ! tu sais, vieux, en France, on n’a pas de rancune. Non, vrai, pour la rancune, on n’en a pas.
Et il s’allongea avec délices, au plus profond de la paille poussiéreuse.
II
Tout le détachement – six cents hommes environ – connut assez rapidement que « l’on marchait contre les Russes révoltés ». Mais on commença – et c’était une singulière façon de marcher
par séjourner près de trois semaines, sans bouger d’une ligne, au même cantonnement, dans un petit village de la Creuse nommé Féniers.
Les bleus avaient quitté avec plaisir leur vieille caserne de Limoges, en s’apitoyant hypocritement sur le malheureux sort de leurs camarades qui restaient en garnison et connaîtraient les tortures de l’exercice tandis qu’eux-mêmes se gorgeraient de grand air, de lumière et d’émotions vivifiantes. Mais, après huit jours de cantonnement, ils s’ennuyèrent à mourir dans leurs granges étouffantes, puis ils retrouvèrent, comme à la caserne, les longues séances de gymnastique, le service en campagne et même les marches militaires aux alentours du village. Alors ils regrettèrent d’être partis et ils envièrent leurs camarades de Limoges qui, en rentrant de l’exercice, jouissaient de la soupe, de la sortie en ville avec le cinéma et d’un bon lit.
Je n’avais, moi, d’autre occupation que de ranger et d’épousseter mes fioles et médicaments. J’accueillais avec enthousiasme la moindre coupure. Peu de plaies furent lavées, aseptisées, cautérisées, pommadées, pansées comme celle de ce petit soldat qui vint me trouver, un après-midi que je pleurais d’ennui, avec une ecchymose insignifiante du dos de la main et que je ne lâchai qu’une grande heure après, le bras en écharpe, un décamètre de gaze blanche autour du poignet.
Quant à Gental, sa mitrailleuse étincelait ainsi qu’une orfèvrerie de musée. Mais comme il était un paysan et qu’il aimait la terre, il supportait beaucoup mieux que moi le silence et la solitude des campagnes creusoises et il restait, la pipe aux dents, des heures entières, assis sur un tertre qu’ombrageait un sapin, des heures entières à regarder frissonner, dans la lumière changeante du ciel incertain, d’immenses vagues de bruyères aux pentes violettes des collines.
Chaque fois que je me laissais tomber près de lui, après avoir frappé de ma canne l’herbe tiède et les rocs moussus où les vipères aiment à dormir, il ôtait sa pipe de sa bouche, me décochait une œillade de coin* et demandait :
– Quoi de neuf ?
– Rien – soupirais-je en m’asseyant. – On… marche toujours contre les Russes !
Le fait est que nous n’avions point encore avancé d’un seul pas en direction de l’ennemi. Les rares soldats qui se souviennent encore des grandes manœuvres du temps de paix savent combien il leur fallait jadis déployer d’imagination pour redouter le brusque assaut des manchons blancs dans un village où tout dormait malgré qu’on le dénommât « cantonnement d’alerte », oui, tout dormait, depuis le colonel enfoncé dans la « plume » du presbytère, jusqu’aux sentinelles vautrées dans les charrettes à foin qui barricadaient la grand’route. Notre campagne contre les Russes rappela, à son début, les grandes manœuvres du bon temps. Nous n’avions nulle haine contre ceux que nous étions censés combattre. Nous doutions même qu’ils existassent. Pour ma part, j’en arrivais à croire qu’ils n’avaient point davantage de réalité que l’ennemi figuré d’un thème stratégique, quand, un beau jour, les premiers soldats russes firent, à notre stupeur, irruption dans Féniers. Nous nous dévisageâmes les uns les autres avec curiosité, courtoisie et bonne humeur, nous, un peu confus de notre appareil guerrier, eux très à l’aise et forts d’être sans armes.
La situation des adversaires recéla donc, d’abord, un haut comique dont je goûtai toute la saveur. Les Russes évoluaient à leur guise dans le village et sur les routes, montés à cru sur de petits chevaux ombrageux, à la longue queue bruissante. Ils saluaient les sentinelles d’un geste amical ou goguenard et se sentaient tellement chez eux parmi nous que c’en était touchant.
Quand le soir tombait sur la campagne, les Russes, qui sommeillaient tout le jour au frais dans les vastes casernes du camp, sautaient sur leurs chevaux et vagabondaient à l’aventure. Et les collines, toutes noires sur le ciel assombri, nous renvoyaient en échos lointains le roulement feutré des galopades dans la poussière des routes blanches.
– Qui vive ? – criait la sentinelle du calvaire où un vieux christ de granit – sans croix – les pieds joints et les bras levés, paraissait prêt à plonger dans une mer chuchotante de bruyères.
– Camarade Rouski !
Une grosse figure joyeuse, claire dans le crépuscule, apparaissait au-dessus d’une tête de cheval. La sentinelle, n’ayant pas d’ordres, relevait sa baïonnette. Le Russe passait au galop, dans une odeur de cuir. Les fers du cheval clapotaient sur les pavés du village endormi pour s’arrêter net, dans une gerbe d’étincelles, au fond de quelque petite rue sonore et mystérieuse où on attendait le cavalier. Car on les aimait bien. Bons enfants, d’humeur amène, ils avaient une exquise façon de « pas comprendre » les questions indiscrètes. Ils vous regardaient de leurs grands yeux naïfs où il semblait qu’on lût jusqu’au fond, jusque dans cette cervelle sans méandres qui devait emplir d’un seul bloc leurs grosses têtes rondes. On leur demandait ce qu’ils pensaient de la guerre, des Allemands, et comment ces cavaliers intrépides qui, sans étriers, serraient de leurs cuisses épaisses comme des troncs d’arbre les flancs palpitants de leurs chevaux, ne galopaient pas un peu du côté de Verdun ou de Beauséjour :
– Pas comprendre ! La guerre ?… Triste… oui… très triste, la guerre ! …

Et ils riaient, renversant la tête, découvrant un gosier de loup entre deux rangées de dents blanches. Ils faisaient grand usage aussi des bicyclettes de leurs compagnies cyclistes. Car on les avait retirés du front, sitôt leurs premières turbulences, avec leurs armes et leurs bagages. Et nos sentinelles connaissaient bien le grignotement des pneus sur les routes et le froissis des billes qui stridulaient, dans la nuit chaude, comme des cigales.
Les bleus enrageaient. Leurs casques, leurs baïonnettes et leurs cartouches les encombraient, et ils souffraient de se sentir ridicules. En plus, ils étaient jaloux. Ils avaient cru partir pour la guerre et cantonner dans des villages soumis à la seule loi martiale. Ils avaient pris possession des granges, des remises, des greniers en frisant les quatre poils de leurs moustaches et en lorgnant les filles. Mais, si le casque et la jugulaire virilisaient leurs profils jeunets, ils ne pouvaient faire un pas sans semer des cartouches derrière eux, sans accrocher leurs baïonnettes aux jupes des femmes ou aux barreaux des chaises. Les Russes, qui ne semaient derrière eux que l’argent, qui n’avaient point de baïonnettes et dont les lèvres rouges transparaissaient au travers de leurs soyeuses et blondes moustaches, triomphaient avec nonchalance. Et il y avait beau temps que les bleus qui, chaque matin, faisaient la gymnastique sur la place de l’Église, n’attendaient plus rien hélas de la séduction de leurs torses nus, blancs et grêles, tandis que les filles distraites, retenant d’une main leur jupon aux hanches, relevaient de l’autre leurs cheveux dépeignés, dans le jaillissement des fontaines, sous les platanes dont l’ombre noire était toute jonchée de ronds d’or.
Le malheur est qu’on ne pouvait point se fâcher. Nulle occasion, aucun ordre d’intervenir. Les Russes riaient beaucoup et le rire est presque aussi contagieux que le bâillement. Je me souviens qu’un soir, la section de garde au calvaire fit une manœuvre impeccable, toute cliquetante de
bruits de crosses en l’honneur de trois fillettes, qui, un doigt dans la bouche, contemplaient de leurs grands yeux anxieux et admiratifs ces jeunes soldats qui jouaient à la guerre. Les faisceaux alignés, les bleus, derrière, tout raides, au garde à vous, attendaient que le sergent commandât : « Rompez ! ». Au détour du chemin, un Russe surgit, sur un petit cheval écumant qui se cabra net, sauta rageusement sur place, arrosant de terre les soldats immobiles et recula, la bouche sciée par le mors, dansant sur ses jarrets pliés comme un cheval de cirque, dans les faisceaux qui s’écroulèrent. Le Russe bondit à terre, reçut un jet d’écume en plein visage et corrigea sa bête à grands coups de cravache qui zébrèrent le pelage lustré de sueur. Puis il s’excusa en souriant d’un air apitoyé :
– Petits fusils par terre… Oh ! … chagrin… pourquoi fusils ? …
Il resta là, perplexe, grattant sa tête rousse, à côté du petit cheval qui tremblait sur ses jambes fines. Et les soldats, dont plus d’un avaient pâli de rage, ramassèrent leurs « petits » fusils sans rien dire. Il y avait un homme qui sentait jusqu’à la souffrance le comique de la situation. C’était notre commandant. Trente mois de front dont huit sous Verdun lui avaient fait concevoir la haine de la guerre et l’amour du soldat français. De mémoire d’homme, il n’avait jamais puni un poilu du bataillon. Non point qu’il ne commandât que des saints ou des héros, mais il connaissait la manière qui faisait merveille de regarder mélancoliquement le coupable, de ses bons yeux qui luisaient dans sa face barbue et de lui dire avec une émotion qui n’était pas feinte :
– Comment ! C’est vrai ce qu’on me raconte de toi ? Toi qui as fait Fleury, Souville et la cote 304 ? Je ne peux pas le croire ! …
Il souffrait du ridicule de ses soldats et il supportait avec impatience les cavalcades russes. À sa table où il nous traitait deux fois la semaine, le major et moi, le major parce qu’il l’aimait beaucoup et moi parce que, disait-il, il m’avait vu pas plus haut que ça (je l’avais connu lieutenant à Lille), il dévoilait ses ennuis sans contrainte. Il commençait avec une douce ironie :
– Concevez-vous, mon cher docteur… (Une galopade de Russes faisait sonner les vitres et il fermait le poing.) Qui est-ce qui nous a fichu, mon cher docteur, ce N. de D. de métier d’idiots ?
Nous étions à dîner, un jour, quand un planton lui remit un pli urgent de la part du général.
– Ah ! Ah ! – dit le commandant, en croisant les jambes avec satisfaction, j’espère que cette fois nous allons en finir et qu’on va poser des conditions sérieuses à tous ces écuyers de malheur !
Il décacheta l’enveloppe, lut et poussa un juron formidable :
– Mon cher docteur, – dit-il au major, – le ciel vous garde d’être jamais nommé commandant. Savez-vous ce qu’on veut de moi ?… Non ?… Que je fasse des prisonniers ! Ça, c’est vraiment beau ! Pour où les mettre ? Qu’est-ce j’en ferai ? Va-t-on publier aussi un communiqué officiel du camp de la Courtine ? On fit les prisonniers. Et les bleus s’amusèrent énormément. Le commandant les interrogea, comme il interrogeait les Allemands, là-bas, du côté du fort de Vaux. Quand on vous amène des prisonniers, même si vous ne savez qu’en faire, vous commencez par les interroger : c’est de règle. Mais le commandant n’avait pas d’interprète et les Russes ne connaissent guère le français. Les interrogatoires ne donnèrent rien de bon. À cheval sur une chaise, devant la porte d’une grange qui exhalait une odeur de foin et de pain chaud, le commandant, vareuse ouverte, répétait sur tous les tons, du doux au violent en passant par l’acerbe :
– Qu’est-ce que vous faites, dans votre camp ?. ..compris ?… dans votre camp?
Les Russes répétaient péniblement :
– Dans… vo… tle. camp…
– Yes – ja – oui – si – parfaitement – disait le commandant.
Et il s’appliquait à articuler fortement les syllabes comme s’il était aux prises avec un morceau de viande dure :
– Dans vo-tre camp de la Cour-tine. Compris ?
Alors, les prisonniers, la tête de leurs chevaux sur leur épaule, tout contre leur joue, se regardaient, riaient a pleine bouche, se balançaient lourdement sur leurs pieds bottés en affirmant :
– Camarades… oui. .. Rouski… Voilà !
Le commandant, esclave de la consigne, leur tenait un discours enfiévré où il était question « de grands gaillards forts comme des Turcs… zut ! non, je veux dire forts comme des … machins, et qui ne faisaient plus que la chasse aux femmes de la Creuse » Et il se frappait violemment la poitrine, à gauche sur le cœur « pan ! Pan ! » Et les prisonniers, suivant son geste, dégrafaient leur tunique et péchaient dans la poche gauche un livret graisseux ou « il n’y avait rien, Mossié, rien du toute ! » Les chevaux emmenés par les dragons, les prisonniers s’allongeaient dans la grange, sur la paille. On fermait la porte au loquet et le commandant s’en allait dans son bureau pour y attendre des ordres. Alors, passant la tête par une chatière dans la grange, je voyais un long rayon d’or où flottaient des poussières couper l’ombre d’encre et tomber tout droit du toit sur la face camuse d’un captif. J’entendais des ronflements bruire, une grosse mouche bourdonner, une vache mugir et tirer le foin de la mangeoire en un léger froissement de soie. L’ennemi dormait.
– Concevez-vous, mon cher docteur?. .. Foutu métier ! Les rebelles sont dix mille. Bon. Si j’en prends dix par jour, nous en avons pour trois ans.
– Vous en prendrez plus de dix, mon commandant.
– Dieu vous bénisse, mon cher docteur, alors je ne saurai plus où les mettre !
En effet, toutes les granges du village sentaient bon le cuir de Russie. On aurait cru en suivant les rues tranquilles, au crépuscule, se promener au fond d’un portefeuille. Les dragons comptaient six chevaux par homme et le cycliste du commandant songeait à ouvrir dans une écurie abandonnée un magasin de bicyclettes. Mais les bleus ne se lassaient point de ramener des prisonniers. Ils défilaient avec ivresse à travers tout le village, encerclant quelque colosse qui souriait aux filles par-dessus les baïonnettes. Ils croyaient triompher enfin, mais ils ne pensaient point qu’ils auréolaient les vaincus d’une gloire de souffrance et de faiblesse et que les Russes avaient maintenant non point seulement l’amour des femmes, mais leur pitié.
III
Pour dire vrai, notre expédition n’était point si stupide. Si elle vous semble incohérente, c’est que je préfère vous raconter ce que j’en ai vu plutôt que ce qu’on m’en a dit. Et vous savez qu’un soldat ne voit pas grand’chose d’une bataille non plus que d’une manœuvre.
Vers la fin du mois d’août, quelques randonnées en automobile avec le major m’apprirent que, tout autour du camp de la Courtine, il y avait des bataillons comme le nôtre, reliés entre eux par des grand’gardes, des petits postes, des patrouilles, et que tout cela faisait une chaîne assez solide. Ces randonnées me fournirent également, sur notre rôle, notre place, notre but et la situation générale, quelques précisions qu’il est temps que je vous soumette.
Vous savez que, en 1916, deux ou trois brigades russes vinrent en France combattre sur notre front et occupèrent le secteur de Champagne. Elles se conduisirent avec vaillance à Croucy et en maints endroits. Dès le mois d’avril 1917 le corps expéditionnaire russe subit le contrecoup de la révolution avec autant de violence et d’enthousiasme – m’a-t-on dit – que s’il eût combattu sous Stanislau ou dans les marais du Pripet. Leur bouleversement fut si grand qu’on ne put les laisser en ligne.

Retirés au camp de Mailly, ils se partagèrent, après d’orageuses discussions, en deux groupes ennemis. Le premier, fort d’environ cinq-mille hommes (je ne puis naturellement garantir aucun chiffre), se déclara prêt à soutenir le gouvernement de Kerensky et à continuer à nos côtés la guerre contre l’Allemagne. Le second, qui comptait dix mille soldats et sous-officiers, adversaires de Kerensky, tint des meetings, forma des soviets, élut des délègués et sema à tout vent la bonne parole communiste. Kerensky demanda leur retrait du front. Et ils furent cantonnés dans le camp de la Courtine, qui dresse sur un plateau de la Creuse, parmi de grands arbres, les murs blancs et les toits rouges de ses casernes neuves.

La Creuse et la Corrèze sont de belles régions que leurs collines ravinées, leurs cascades ni leurs bruyères mélancoliques n’empêchent d’avoir de bonnes routes favorables aux courses à cheval. Friands de cyclisme et d’équitation, les rebelles trouvèrent leur camp trop étroit et ils se mirent à rayonner en tous sens, à travers le pays, en confiant à qui voulait les entendre que Kerensky était un insupportable tyran, le capitalisme la gangrène du monde, et criminelle la guerre contre l’Allemagne. Pour prouver, sans doute, que l’argent n’a nulle importance et ne confère aucune supériorité, ils le jetaient des deux mains, et les minuscules villages de Corrèze connurent rapidement la théorie du bolchévisme et le tourment de devenir capitalistes.
Kerensky estima ne pouvoir admettre les libertés que prenaient les rebelles vis-à-vis de la discipline et de son gouvernement. Il fit donner aux cinq mille loyalistes l’ordre de s’établir en un long cordon sur les collines qui enclosent le camp de la Courtine. Et la République française mit à la disposition de la République russe des troupes qui servirent à doubler ce cordon et même à le tripler. Voilà, je crois, en gros la situation à la fin du mois d’août 1917. Que les rebelles voulussent ou non continuer la guerre et reconnaître l’autorité de Kerensky, c’était leur affaire et l’affaire de Kerensky. Mais, comme ils étaient en France et qu’ils ne pouvaient pour l’instant regagner leur pays, notre présence à nous, Troupes de Protection (c’était notre nom officiel), signifiait seulement que nous entendions faire régner l’ordre chez nous et que nous ne saurions tolérer le tapage dans notre maison. Voilà tout, et je crois être impartial.
Cette expédition du camp de la Courtine, dont les journaux ne purent parler, les imaginations l’ont transformée en je ne sais quelle sombre tragédie. On murmurait, quand j’y faisais allusion, les mots de lâcheté, d’injustice, de crime, que nous étions tombés à cinquante mille (!) sur une poignée de pauvres moujiks qui réclamaient leur liberté. C’est faux. Notre rôle, je l’affirme, se borna à garder l’arme au pied, en supportant parfois, du fait des rebelles et des paysans, de cuisants affronts, sans nous rendre coupables d’aucune provocation. J’ai assez voyagé pendant les quinze premiers jours de septembre autour du camp pour pouvoir vous dépeindre à bon escient l’attitude des troupes françaises en cette aventure. Et mon ami le caporal-mitrailleur Gental, socialiste d’extrême-gauche, à qui je lisais ces notes le mois dernier, m’assurait une fois de plus que jamais il n’avait eu besoin de violenter, pour obéir aux ordres donnés, ses principes ni sa conscience.
……………………………………………………………………………………………
Je vous disais donc et ce n’est pas nouveau que les soldats, qu’ils soient des camarades, des citoyens, des sujets ou des mercenaires, ne savent jamais ce qu’ils font ni où ils vont.
Ayant passé trois semaines à Féniers, nous embarquâmes un beau matin à destination du village de Clairavaux, le Claravallis de la Gaule romaine, là où, quinze cents ans plus tôt, les Wisigoths, lointains ancêtres des Russes, administrèrent aux Gallo-Romains une si magistrale rossée. Mais aucune idée de revanche n’enfiévra notre départ.
IV
Nous ne séjournâmes à Clairavaux que quelques jours et sans rien faire qui vaille d’être rapporté. Puis, pendant la première semaine de septembre, nous émigrâmes vers d’autres villages de Corrèze, de plus en plus petits et misérables à mesure que nous approchions du camp. Nous croisions en chemin des dragons et de l’infanterie française récemment amenés du front et des troupes russes loyalistes.
Nous retrouvions, Gental et moi, sur les routes encombrées, aux cris des conducteurs, parmi les convois grinçants, des impressions qui dataient de trois années, quand le premier corps se concentrait autour d’Hirson, en août 1914.
– Te rappelles-tu, vieux ? – disait Gental avec mélancolie, –comme c’est loin, tout ça ! On savait pas… on s’doutait pas qu’on s’embarquait pour si longtemps, pour si loin !…
– Ni qu’on sèmerait, – disais-je, – tant de braves camarades en route…
– Misère, soupirait Genta!, te rappelles-tu le caporal Bourriez… le petit Heens… le gros Lebon…
– Et Rentiez qui souffrait le martyre et qui marchait, marchait, marchait, sur ses pieds en sang.
– Oui… Brave type ! … y disait « J’arriverai à Berlin su’ les genoux, su’ la tête, ou p’têt’ ben les pieds devant. Mais j’y arriverai, bon Dieu! »
– Il s’est arrêté à Dinant… Une balle compatissante lui épargna le voyage.
Une batterie russe de 75 roulait près de nous. Gental regarda les canons muselés de cuir noir et frissonna :
– Est-ge qu’on va encore mourir ? – s’écria-t-il, – s’accrochant à mon bras. Est-ce qu’on va encore tuer ?
Un lieutenant d’artillerie russe qui passait à cheval avec la dernière pièce entendit Gental et fixa sur lui un regard si douloureux, si compréhensif, que j’en fus secoué jusqu’aux moelles.
– C’est drôle, – dit étrangement Gental, en changeant son mousqueton d’épaule, – je ne suis pas à mon aise. Là-bas, tu comprends, à Verdun, ou à Reims, ou à Arras, ça tombe, ça tue, ça claque, ça siffle ! On n’a pas le temps de penser. Ici, vieux frère, tu vois, c’est l’été, on n’entend rien, ça sent bon ; et nous, on arrive avec des trucs, des engins, des fourbis à casser des gueules… – II hocha tristement la tête. – Ah vieux, – dit-il d’une voix creuse, – j’en ai marre !
Et je compris avec émotion que Gental, le simple et bon Gental qui marchait à mes côtés, ressentait confusément toute la poésie du poignant crépuscule et que le mystérieux bruissement du vent frais dans les bruyères chantait à son cœur de paysan l’appel du sol, l’amour des hommes et la haine de la guerre.
– Vieux, – dit-il en tremblant, – s’ils croient que c’est pour not’ plaisir… ben vrai ! … c’est pas si rigolo… hein?… d’obéir !
Il dépendit brusquement le mousqueton de son épaule et regarda de très près l’acier qui rougeoyait aux dernières lueurs du soleil. Sur la batterie huilée, une larme tomba, ronde et scintillante comme une pierre précieuse.
Je pris Gental par le cou : – Je t’aime bien, lui dis-je tout bas.
V
Engagés depuis près de cinq semaines dans l’engrenage des pratiques militaires, accoutumés de longtemps à obéir – et nous en faisant gloire – nous ne nous posâmes jamais la question : « Ne prêtons-nous point notre force et notre discipline à quelque louche entreprise ? » Pourtant le silence des journaux nous donnait à croire que nous étions loin d’obtenir l’assentiment de l’opinion publique.
– Rien ! – disait Gental en froissant son journal. – Encore rien… Pas une ligne… Doit y avoir là-dessous un sale mic-mac !
Mais, comme notre parade guerrière, si elle menait grand tapage, ne faisait aucun mal, notre conscience – sinon notre corps – était en repos. Arrivés à Baune tout près du camp, le 12 septembre vers neuf heures du soir, nous pataugeâmes, Gental et moi, dans le fumier des ruelles obscures, en cherchant la bicoque qu’on nous avait désignée pour installer le poste de secours. Le médecin-major et les autres infirmiers logeaient à Sornac. Quant au bataillon, il apprit avec allégresse qu’il passerait la nuit en plein air. Et les soldats, heureux d’échapper à la fange des hameaux de Corrèze, s’étendirent dans l’herbe mouillée, sous le grand ciel ruisselant d’étoiles.
Notre logeur nous attendait sur le seuil de sa maison, une lampe à la main. C’était un géant tuberculeux avec des pommettes rouges sous des yeux morts. Il bouchait la porte et toussait sans trêve, d’une toux irritée qui déroulait dans sa poitrine des chaînettes rouillées.
– Qu’est-ce que vous voulez ? – nous demanda-t-il d’une voix faible. – Foutez-leur donc la paix… hanhan… rrrrr… à ces pauvres Russes. Ils n’en veulent plus ? Le beau malheur… rrrr… Tout le monde est comme eux… hanhan… Seulement, ils osent… rrr… le dire.
Une quinte de toux le secoua. Ses poumons se vidèrent en sifflant, gargouillèrent pour s’emplir. Il releva le col de sa veste.
– Il est tard, – dis-je,- il fait frais… vous êtes enrhumé… vous devriez être au lit… Laissez-nous faire. Nous ne dérangerons rien. Six brancards, deux cantines, et c’est tout.
Il me tourna d’un air furieux son large dos tremblant et soupira entre deux quintes :
– Misère de misère ! Vous autres soldats, vous commencez à emm… le monde.
Il monta lourdement les marches geignantes d’un vieil escalier de bois,et, au moment d’entrer dans sa chambre, laissa tomber sur nous ces paroles avec la clarté de sa lampe
– Prenez garde ! Vous êtes en train… hanhan… rrr… de faire une cochonnerie.
La porte claqua.
– Fiiiou – siffla Gental stupéfait.
La bougie allumée, nous installâmes sans mot dire nos brancards dans une sale petite chambre, le long des murs de torchis. Suspendus à une grosse poutre qui traversait tout le plafond, un jambon et des gousses d’ail se balançaient chaque fois qu’on ouvrait la porte.
– M’étonne qu’il ait laissé ça, – murmura Géntal. Il réfléchit une seconde, plissa son front, puis : – Non mais qu’est-ce qu’il nous a cassé, l’père !
Nous nous allongeâmes sur nos brancards. Gental souffla la bougie.
La pleine lune dessinait sur le plancher le carré blanc de la fenêtre et le velours noir du feuillage.
Sur nos têtes, un pas lourd ébranlait le plafond et le jambon dansait comme un pantin au bout d’un fil. L’éclat d’une toux lointaine nous arriva. La dernière phrase du paysan vibrait toujours à mon oreille « Vous allez faire une cochonnerie !» J’entendais près de moi le souffle court de Gental aux prises avec un mauvais rêve.. Je voulus l’éveiller. Je lui touchai le bras. Il se retourna tout d’une pièce sur son brancard et bredouilla très vite:
– Je suis un brave homme. .. oui… brave… bra-a-ve…
Quelle triste nuit !
VI
– Non, voyons, nous n’en sommes pas là ?
Le commandant qui venait de remplir le verre du major, demeurait immobile, penché sur la table, serrant de sa grosse main velue la bouteille de vin rouge.
– Nous n’en sommes pas là, voyons, monsieur ?
Un lieutenant russe assis au bord d’une chaise, sa casquette plate sur les genoux, faisait signe de la tête « Si, si, nous en sommes là ! »
– Mais ça va s’arranger, voyons. Ce sont des fous, vos rebelles. Je ne les aime pas, Dieu ! non. Ils me font faire le Jacques depuis plus d’un mois. Mais taper dessus ?. .. Ah ! zut!
Le lieutenant Prakoff ramena son sabre entre ses jambes, croisa ses mains sur le pommeau et soupira. Nous finissions de déjeuner dans la petite chambre du commandant. Il faisait une chaleur effroyable. On avait fermé le volet et dans l’ombre bleue bourdonnait une mouche. Au milieu de la table, sur une assiette étincelante, un rayon tombait autour duquel s’enroulait la fumée des cigares.
Le lieutenant Prakoff parla lentement en roulant les r.
– Kerensky l’a dit… oui, Kerensky… Ils ont jusqu’à demain… demain… dix heures.
– J’en suis abruti, – dit le commandant.
Nous entendions les canons cahoter au dehors. Une procession d’ombres défilait au plafond et les verres tintaient.
– Je ne peux pas le croire, – dit le commandant qui, tête basse, ratissait du bout de son couteau la cendre dans son assiette.
Prakoff se leva et poussa le volet. Dans un flot de soleil et de poussière, nous vîmes passer l’artillerie russe.
– C’est ma batterie, – dit Prakoff.
Il restait debout. Il était beau dans sa tunique grise et sa culotte bleue moulée jusqu’à mi-cuisses, bouffante au-dessus. Il avait des cheveux d’un blond d’or. Je le reconnus. C’était ce lieutenant qui, l’autre soir, avait regardé Gental avec tant de tristesse. Cliquetis de chaînes… grincements de roues… un caisson passa, dansant si lourdement sur les pierres de la rottte que la maison frémit. Prakoff nous le montra :
– Il n’est pas vide, n’est-ce pas?
Sur le siège, trois soldats russes tressautaient ensemble.
– Eh bien, monsieur, – dit le commandant, – je vous plains, oui, tout à fait… Nous ne serons, nous autres, que spectateurs… C’est largement suffisant. Oh ! Oh ! c’est très suffisant.
…………………………………………………………………………………………………………
Je passai avec Prakoff une soirée cordiale. C’était un excellent musicien. Nous parlâmes de Borodine, de Glazounow, de Strawinsky. Couchés sur un talus dont l’herbe roussie gardait encore la grande chaleur du jour, nous respirions le vent du crépuscule qui clapotait dans les feuilles comme un ruisseau sur des cailloux. A nos pieds, dans l’ombre, la batterie de Prakoff faisait la soupe et les grosses marmites de fonte entourées de flammes léchantes semblaient d’étranges tulipes noires dans des corolles d’or. La voix lointaine d’un chanteur nous arriva soudain, cristalline, toute baignée d’air limpide. Je quittai Prakoff vers onze heures..
– Bonsoir, monsieur, – lui dis-je, – il est tard.
– Oui, – dit-il tout bas, – c’est déjà presque demain… demain…
– Ne vous tourmentez pas, –lui dis-je, – ils se rendront. C’est certain.
– Il le faut, n’est-ce pas, monsieur. Il le faut. Ce serait terrible !
VII
Dimanche 16 septembre.
– Mais enfin… enfin… qu’est-ce qu’ils veulent au juste ?… Qu’ils parlent ! Qu’ils disent quelque chose !
Le lieutenant Prakoff se lève brusquement, fait trois pas, se rassied, s’éponge le front. Temps radieux. La batterie de 75 est installée le long d’une route à flanc de coteau. Les quatre petites têtes des canons, sortant des arbres qui bordent la route, dominent la vallée où roulent des verdures à grands plis de velours. Tout en bas les toits rouges et bleus du camp brillent parmi les feuilles. On doit tirer à dix heures juste. Il est neuf heures.
Je suis assis près du lieutenant. Un soldat russe, à genoux devant un caisson ouvert, compte les disques de cuivre des obus. Un adjudant écorce une baguette en regardant au loin.
Prakoff tire sa montre et la balance au bout de sa chaîne. Le verre envoie des rayons dans les yeux de l’adjudant qui les écarte distraitement de la main, comme on chasse une mouche.
Les têtes des chevaux apparaissent entre les arbres, mâchant des branches qui craquent. Cliquetis de mors, renâclements. Les canonniers sont allongés dans l’ombre courte de leurs pièces.
L’adjudant fatigué s’assied à croupetons sur les talons de ses bottes plissées. Ses cuisses musclées tendent l’étoffé grise de sa culotte. J’imagine qu’il va commencer une danse nationale. Mais il lève sur le lieutenant des yeux douloureux de chien fidèle. Le temps passe. On le sent qui s’écoule. Il semble que le grincement des grillons batte les secondes. Sur nos têtes, le ciel est d’un bleu luisant, sans nuages, comme pour laisser libre l’ascension du soleil, et les ombres noircissent tandis que le soleil monte. La botte d’un servant couché sous la première pièce miroite comme une moire. Il retire son pied sous lui à mesure que l’ombre diminue.
Neuf heures et demie.
– Mais enfin, qu’est-ce qu’ils veulent au juste ?… Est-ce –qu’ils vont se rendre? – me demande le lieutenant Prakoff.
Je n’en sais rien, mais rien du tout. Je fais un geste vague. Je n’ose pas parler. Je regrette d’être venu. Que dire à ce Russe qui souffre un martyre tout en jouant négligemment avec sa montre étincelante ? Il déplie son mouchoir. Il s’essuie le front. Puis il regarde au loin, très loin, et je sens bien qu’il cherche le cœur de la patrie par-dessus les collines de la Creuse. Il mord ses lèvres un bon coup, puis, lâchant sa montre qui tourbillonne au bout de sa chaîne, il cueille d’un doigt soigneux des brins d’herbe sur sa vareuse. En tirant sa manche, il voit ses boutons d’uniforme et commande d’un ton ferme :
– Debout !
Les canonniers se lèvent sans hésiter et tombent en grappes autour des pièces, à leurs postes.
– C’est bien ! – murmure Prakoff.
Une larme roule dans ma moustache et mon cœur bat.
L’alliance franco-russe ! Les cosaques à cinq étapes de Berlin !
Prakoff donne des chiffres. Les soldats tournent des roues de cuivre et les têtes grises et malfaisantes des canons montent en froissant les branches et se pointent, rigides, vers le ciel. Comme l’obus disparaît dans la première pièce et que la culasse claque net comme une serrure bien huilée, un nuage blanc masque soudain le soleil et l’ombre galope, ternit les verdures, éteint les reflets de l’acier. Prakoff tressaille et tire sa montre. Mais la petite aiguille sautille sans arrêt il n’y aura pas de miracle. En même temps que revient le soleil, un chant jaillit là-bas du camp des révoltés. Prakoff me regarde :
– Il faudra tirer, – dit-il. – Ils ne se rendront pas.
Un servant agenouillé contre la bêche du canon accompagne en sourdine le refrain du chant révolutionnaire.
– Tais-toi, – dit Prakoif.
II se retourne vers moi et, plongeant son regard jusqu’au fond de mes yeux
– Ils peuvent se tromper, me dit-il. Mais s’ils savent mourir, ils ont droit au respect.
Le canon est là, ramassé, mystérieux : c’est une bête qui rêve. Une horrible angoisse me tenaille le cœur. Je vais m’enfuir. Dix heures. Prakoff lève la main. Le canon bondit en arrière, aboie et repose lentement sa tête entre ses pattes, comme un chien qui brusquement s’éveille, montre les dents et se recouche, calmé. Toute la vallée gronde. L’obus file, coupant l’air avec de grands ciseaux grinçants. Un.éclair fulgure dans les arbres du camp. La musique cesse. Des cris, des hurlements. Trois coups de canon bousculés, l’un sur l’autre. Un roulement de caisses vides et de ferrailles emplit la vallée où tournoie un vol d’oiseaux. Tout se tait. Nous sommes pétrifiés. Nous écoutons stupidement les grillons moudre le temps et grignoter les secondes.
VIII
L’après-midi, ayant pioché deux sardines dans une boîte que me tendait Gental, je voulus remonter voir Prakoff. Pour retrouver la batterie, je suivis longtemps la vallée, marchant .à travers les bois bleu et or, dans l’ombre humide et chaude où brillait l’herbe grasse. Cependant la batterie russe lâchait méthodiquement un obus toutes les trente secondes. Le coup du départ grondait sous la sonore colonnade des arbres. Des nuées d’oiseaux effrayés voletaient, pépiaient, puis se taisaient. J’entendais l’obus gargouiller dans le ciel étincelant. Après un bref silence, le choc de l’explosion m’arrivait, assourdi et je sentais sous mes pieds frémir la terre. Une autre pièce tirait. A quelque quarante mètres au-dessus de ma tête, une flamme luisait dans les feuillages. Le souffle torrentiel du canon roulait par tout le bois, secouant des arbres des grappes d’oiseaux criards. L’obus traçait au ciel son long sillage susurrant et quand il éclatait au loin je recevais comme un coup de poing en pleine poitrine. Je retrouvai la batterie. Tous les soldats me dévisagèrent hargneusement. Prakoff ne me vit pas tout de suite. J’aurais voulu lui dire que j’éprouvais une grande pitié affectueuse pour lui. Mais il était assis au bord de la route, les coudes sur les genoux, la tête dans les mains. Je n’osai pas lui parler. Longtemps je regardai la lourde danse métallique des canons. Pas une voix humaine n’allégeait la torpeur de cet après-midi. Les servants, maussades, enfermés chacun en soi-même, faisaient sans mot dire leurs gestes habituels, tiraient l’obus du coffre, l’enfournaient dans la pièce, claquaient la culasse. Le chef de pièce levait la main d’un air ennuyé : brusque ruade du canon, cliquetis, éjection de la douille fumante puis tout le monde se recouchait – canon et servants – sans une parole. Et, tandis que les canonniers de la deuxième pièce se dressaient à leur tour, l’obus qui n’intéressait personne – qu’on méprisait, qu’on haïssait peut-être – s’ouvrait là-bas, dans les arbres verts du camp, comme une jaune fleur vénéneuse.
Quand Prakoff m’aperçut, il vint à moi vivement :
– Avez-vous des nouvelles?
– Aucune, -lui dis-je. – Est-ce qu’ils sont tous morts ? Mon patron est allé au quartier général. Rien ne bouge là-bas.
– J’espère, – dit ardemment Prakoff, – que nous n’en avons tué aucun. Savez-vous où les premiers obus ont porté ?
– Les dragons disent qu’ils ont éclaté juste sur le camp, mais…
– C’est terrible –dit-il.
– Oui, – dis-je.
Et comme sa figure grimaçait de souffrance :
– Allons donc !– repris-je, en appelant à mon secours les lieux communs. – Allons donc ! On vous a commandé, vous avez obéi. Puisque la Russie continue la guerre à nos côtés, tous ceux qui refusent de marcher sont des traîtres.
– Mais qui est la Russie ? – dit Prakoff
Je négligeai cette question.
– Vous aviez,- dis-je avec force, – un bras gangrené, vous avez taillé dedans. Vous êtes amputé, mais vous êtes sauf.
– Oui, -murmura Prakoff, – on taille en pleines chairs… Ça saigne… ça fait bien mal.
Il baissa la voix :
– Kostia est parmi eux, vous savez.
– Qui, Kostia?
– Mon frère,– dit Prakoff.
– Ssss… –fis-je d’un sifflement apitoyé. Puis je bredouillai : – Il fallait, voyons, refuser… expliquer…
– Expliquer ça, oui ? Vous êtes bon, vous. Et d’ailleurs, quelle différence faites-vous entre mon frère par le sang et mes frères par la race ? J’ai écrit à mon père que Kostia était mort en France, à Croucy. face aux Allemands. Car c’est à Croucy que, pour la dernière fois je l’ai vu soldat, après l’attaque, sale, plein de boue, mais très content… Ensuite, au cantonnement, il n’a plus fait qu’un métier d’orateur… Pour moi, la guerre est encore longue. Mille occasions, mille belles occasions de mourir. Il était très rouge, avec des pommettes enflammées. Il tourna rapidement sur les talons.
– Je vous demande le secret (1),- dit-il gravement.
(1) Il va sans dire que Prakoff ne s’appelait point Prakoff, ni son frère Kostia. D’ailleurs, le lieutenant est mort sous Montdidier, en mars 1918.
IX
Mardi, 18 septembre.
Le bombardement qui, la veille, a cessé au crépuscule, reprend avec le jour. Deux coups par minute, comme hier.
Il est très tôt. Il fait très beau. Couché sur mon brancard, à côté de Gental qui dort encore, je rêvasse, dans un demi-sommeil pesant que chaque coup de canon soulève et qui retombe ensuite sur moi. Toutes les trente secondes, les vitres grelottent un roulement de minuscules tambours. Puis le soyeux murmure du vent passe dans les feuilles rousses.Tout au loin un coq lance aux échos de la vallée sonore je ne sais quelle clameur indignée. Le bruit d’un moteur au dehors. C’est le major qui vient me chercher pour la visite aux malades. Nous partons. Le major conduit à toute vitesse, comme toujours. Nous suivons une route assez belle qui se déroule parmi les collines violettes. Ce serait charmant s’il n’y avait à gauche un mur de rocs, à droite un précipice. Jamais on ne voit devant soi plus de quarante mètres de route. La course n’est qu’un continuel virage et je me cramponne au coussin de cuir d’où la force centrifuge a juré de m’extirper. Par moments, une odeur délicieuse de café chaud s’unit au frais parfum de l’automne. Nous voyons des soldats s’ébrouer dans la rosée des bruyères.
– Pas de malades ?
– Pas de malades, monsieur le major.
De bonnes figures nous sourient sous des casques bleus, du même bleu d’ardoise que le ciel. Là courte buée blanche des premiers matins frisquets sort des bouches. Comme c’est bon, un quart de jus par une allègre aurore de septembre ! Nous stoppons soudain pour laisser passer une colonne de prisonniers russes qu’encadrent des dragons français. Aucune gêne. Tout le monde rit, dragons et prisonniers. En tête du cortège marche un colosse qui gratte sur son violon un refrain de café-concert. Un dragon, penché sur le cou de son cheval, marchande une magnifique paire de bottes qu’un Russe lui tend à bout de bras et qu’il tourne en tous sens, l’œil finaud.
– Non, – fait le dragon, – vingt francs. Compris ? II ouvre deux fois ses deux mains sous le nez du Russe. Deux fois dix. Compris ?
– Non, mossié, – chantonne le Russe. – Pas possible, vingt francs cinquante. Belles bottes.
L’adjudant qui commande le détachement rougit en voyant le major, salue et s’excuse
– Que voulez-vous, monsieur le major, ça n’est pas des Boches, n’est-ce pas ?
– Mais bien sûr, mon ami.
Tout le monde rit. La bonne humeur flotte dans l’air vif. Devant la maison du commandant un millier de prisonniers encombrent la route. Nous descendons de voiture. Éclats de rire, bavardages, tumulte de foire. Des tranches de pain s’enfournent dans des bouches aux dents blanches. Comme ces Russes sont gigantesques ! Sur l’herbe poussiérieuse d’un talus, en plein soleil, trois ou quatre gaillards dorment de tout leur cœur. On devine la grâce et la force jusque dans leur sommeil bras repliés sous des nuques blondes, cuisses massives, larges poitrines. Pour les interroger, nous usons du dialecte petit-nègre. Les Français parlent petit-nègre à tous les étrangers, qu’ils soient Anglais, Russes ou Chinois. – – hein ? Vieux. Y a pas bon, canon.
Un jeune soldat russe, imberbe, et rieur, s’écrie :
– Canon? Hou… Hou… Mauvais, canon.
Et il cache sa figure de son bras levé, comme un gosse qui craint une taloche. Mais un camarade l’écarte d’une poussée et nous!dit rudement
– Nous pas peur ; mossié, nous, soldats. Compris ?
Avec une dignité qui nous émeut, il désigne la croix de guerre française sur sa poitrine.
– Nous… beaucoup faim. Oui. Voilà pourquoi. Compris ?
Des prisonniers dégrafent le col leur tunique, relèvent leurs manches et nous montrent leur cicatrices :
– Éclat obusse… balle mitraillouse… Croucy oui… Champagne.
Les bleus qui entendent le canon pour la première fois ouvrent de grands yeux admiratifs.- Et ils n’éprouvent d’autre sentiment pour leurs prisonniers qu’une amitié respectueuse.
Quoi qu’il puisse advenir de la Société des Nations, du désarmement, du progrès social, le courage forcera toujours l’estime.
– Concevez-vous, mon cher docteur?
Le commandant se promène avec le major parmi la cohue.
– Drôle d’histoire, – murmure-t-il – Je donnerais gros pour être à Douaumont. On sait toujours, parler aux Boches. Mais à ceux-ci ? … à ceux-ci ? …
Il fait un brusque demi-tour et je vois qu’il a logé dans sa bouche un morceau de sa moustache qu’il ronge rageusement. Après le déjeuner, nous remontons en auto. Nous, approchons du camp des rebelles. Le temps se gâte. Une mauvaise petite pluie embrume d’un seul coup tout le paysage. Il fait froid. Nous nous réfugions sous la tente du capitaine D…, un du ami du major. C’est ici l’extrême pointe des troupes françaises. Nous sommes au faîte d’une colline que cingle le vent, que la pluie fouette. Tout en bas on distingue à peine le camp qui disparaît sous l’averse furieuse. Il n’y a plus devant nous que les Russes – les fidèles, et les révoltés – entrain de s’expliquer.
L’explication est laborieuse.
Nous sommes quatre sous la tente : le capitaine D…, le major, un sous-lieutenant et moi.
Deux fois par minute, le canon frappe lourdement l’air mouillé. C’est comme un coup de poing dans portière de cuir. Puis l’explosion de l’obus fait le bruit gras et métallique d’une rame de wagons vides qui s’entre-choquent. Entre les coups, le silence ruisselant nous enveloppe.
– Les derniers tiennent dur – dit le sous-lieutenant
– Combien en -restent -il dans le camp ? – demande le major.
– Deux ou trois cents, – dit le capitaine D… – Neuf mille quatre cents se sont rendus. Il ne reste que les chefs… les convaincus… Parait qu’ils sont enragés !…
– Haoup ! … Jiiiii… Crrran….
Religieusement, nous écoutons s’éteindre les derniers échos de l’explosion. Le bruit du canon éveillera toujours chez les fantassins un monde de souvenirs et d’émotions.
– C’est tout de même un peu dégoûtant, – murmure le sous-lieutenant, – cette canonnade
méthodique… C’est du travail d’usine… Trouvez pas ?… S’ils ne sont pas d’accord là en bas, qu’ils s’expliquent, qu’ils s’engueulent, je sais pas, moi, qu’ils se flanquent une bonne peignée à coups de poing…
– Sortons un peu, – dit le capitaine. – On étouffe ici.
Dehors, les dernières gouttes de l’averse cliquettent sur nos casques. Un pâle soleil glisse dans les bruyères, parmi les arbres luisants. Soudain de sourdes rafales de mitrailleuses craquent tout autour du camp. Une balle siffle très haut par-dessus nos têtes.
– Ah, vous êtes là ? mon cher docteur.
C’est le commandant qui nous rejoint, bonhomme et barbu, sous son caoutchouc trempé. Une clameur profonde jaillit du camp. Tout un chapelet de détonations s’égrène à la façon d’un feu d’artifice.
– Les malheureux ! – murmure le commandant, – les malheureux ! …
Il passe sa main sur son front moite et l’essuie avec son mouchoir. Une fraîche brise égoutte les arbres. Le dos vermeil des collines s’arrondit sur le ciel dégagé. La brume blanche des soirs d’automne monte paisiblement du creux de la vallée où résonnent des coups de feu, des cris perçants, des hourras.
– On se bat depuis trois ans pour tuer la guerre, – dit le commandant avec un rire nerveux. -Eux aussi, là, dans le camp… Elle a la vie dure, la guerre ! …
Une rumeur triomphale mugit, ample, creuse et lointaine, comme ces ovations qu’on entend dans le phonographe. Puis tout se tait.
– Voilà, – dit le commandant – je crois que c’est fini.
Il a dit cela du ton dont l’infirmière annonce la fin d’une opération difficile, d’un accouchement pénible.
Nous restons longtemps immobiles dans le soir qui descend du ciel assombri. À nos pieds la rouge flamme d’un incendie transperce les feuillages du camp. Quelques feux de salve sans doute des exécutions trouent le silence nocturne rapides, sans jugement.Il y a par moments des explosions de cris suraigus. Qui les pousse ? Et pourquoi ?
– L’ordre renaît dans la ville conquise, – proclame le commandant d’une voix grasse de rhéteur.
Il fait trop noir pour que je puisse voir quelle figure il a. Dans le camp, c’est un tumulte visqueux, désordonné, répugnant qui me fait penser aux bafouillements des sangliers dans les cultures, par des nuits sombres. On sent que des hommes pataugent avec joie dans la haine, dans la boue, dans le sang.
Ah ! laisser pour toujours à nos pieds, dans l’ombre, les colères, les crimes et les mensonges humains, et respirer, sur cette colline, les parfums vivifiants de cette nuit d’automne ! …
– Elle a la vie dure, vous savez, la guerre !… – répète le commandant.
Eh ! parbleu, nous savons bien qu’elle est éternelle…
Nous n’en sommes pas plus fiers.
ANDRÉ OBEY
Pour retrouver le texte en pdf.